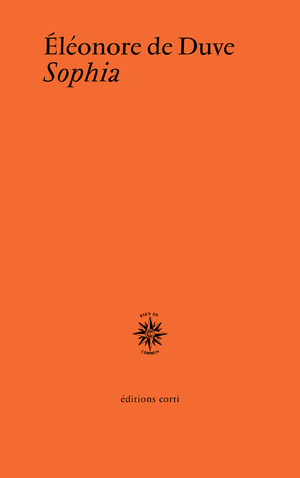
Sophia, ou le temps à rebours, Sophia, ou la luciole.
« Il y a toujours un point où le langage perd son empire. »
On a nos éditeurs préférés.
Ceux qui, en librairie, ou en bibliothèque, attirent notre regard tout de suite. Ceux vers qui on va spontanément. Ceux à qui on fait tout de suite confiance.
Corti, pour moi, est un de ceux-là.
Premier choc de lecture en découvrant à 16 ans Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq, beau livre à couverture blanche, format inhabituel, aux pages non massicotées. Coupe-papier en main on découpe avec précaution les pages, et on a l’impression de trancher dans un mystère qui va s’offrir au lecteur.
Puis ce sera aller de merveilles en merveilles, aussi bien en découvrant les autres romans et essais de Julien Gracq, avec une préférence pour le Château d’Argol. Mais aussi des poètes, mais aussi des romans Gothiques, mais aussi des essais, …
Corti, c’était ça : des livres non massicotés, que les lecteurs ramenaient à la librairie pensant qu’il y avait erreur et que le livre n’était pas « terminé », comme me l’a dit une fois un client en librairie.
Et pourtant, ils sont « terminés », et bien terminés les livres fabriqués par cet éditeur, on a presque envie de dire, avec une petite admiration dans la voix, par cet « artisan-éditeur ».
Et ne pas oublier que la devise de Corti, c’est « rien de commun », et en effet, les livres que publie corti n’ont rien de commun, ils sont à chaque fois des singularités.
Même si aujourd’hui, les livres sont massicotés, ils restent avant tout des singularités, et on doit louer le travail fait par la nouvelle équipe de cette maison d’édition. Un fond remis en avant, des nouvelles voix qui sont proposées. Un travail de fond. Un travail d’éditeur et pas de vendeur de livres.
Cette petite introduction, pour dire, que quand le nouveau livre de Eléonore de Duve est sorti il y a quelques semaines, je suis allé y voir. Avais déjà été emballé, plus qu’emballé, par son premier roman, Donato.
Sophia est le titre de son nouveau livre. Court. Vif. A la limite du poème et du fragment. Tout pour me plaire, déjà.
Première surprise, des chapitres, que l’autrice appelle tableaux, numérotés à rebours, allant de 47 à 1. Aller à rebours, avancer, tout en reculant, s’avancer, dans le texte, au risque de s’y perdre, en ne suivant pas le fil de la chronologie, sans doute. Assez vite, dès le troisième chapitre, on comprend que ce n’est pas une coquetterie littéraire, un truc, mais bien une nécessité. La nécessité de remonter, de revenir.
Sophia danse, dans la toundra.
Voilà que je remets les choses dans l’ordre, car il est écrit, « Dans la toundra, (…), Sophia danse. » Et moi, là, lisant, vous en parlant, je remets dans l’ordre ce pas de danse lu.
Mais je sais que je dois me laisser faire, porter par la main, comme un danseur qui suit son partenaire. Eléonore mène la danse. Le lecteur suit ses pas.
Autant se laisser faire, se laisser aller.
Remonter le temps, comme au fil de l’eau, à rebours, ces poissons remontent le cours.
Cette femme avance dans la toundra, on n’en saura pas plus, fuyant une menace, la mort, des soldats, on n’en saura pas plus. Une guerre vaut toutes les guerres. Une fuite vaut toutes les fuites. Mais une victime n’en vaudra jamais une autre, et chacune fuyant, emporte avec elle sa vie, unique.
« Tuer est une idée qui, mise en pratique, ne fonctionne pas. Le visage, massacré, reste un visage ; et restera l’idée de ce visage, qu’on voulait massacrer – subsiste la somme de tous. Ils survivent, encoignés dans l’esprit, notamment de ceux qui voulaient les tuer car : ils ambitionnaient de tuer ces visages, pour ce qu’ils sont, pour eux. »
Cette histoire, ou plutôt les bouts de cette histoire, est l’histoire d’un visage, un visage, qui, sait l’autrice en lectrice de Levinas, ne peut pas disparaître, ne disparaîtra jamais.
On peut se lamenter sur la disparition, des lucioles, on peut pleurer, comme Pasolini, sur leur départ, mais on peut aussi, à la suite de Didi-Huberman, penser qu’elles sont toujours là, les lucioles. Qu’elles ne disparaîtront jamais tant que certains d’entre nous continueront à vouloir les voir, à les chercher, à les trouver :
« Mais une chose est de désigner la machine totalitaire, une autre de lui accorder si vite une victoire définitive et sans partage. Le monde est-il aussi totalement asservi que l’ont rêvé – que le projettent, le programment et veulent nous l’imposer – nos actuels « conseillers perfides »?
Le postuler, c’est justement donner créance à ce que leur machine veut nous faire croire. (…). C’est donc ne pas voir l’espace, fût-il interstitiel, intermittent, nomade, improbablement situé, des ouvertures, des possibles, des lueurs, des malgré tout. »
Et Sophia est cette lueur, petite lueur au plus profond de la nuit, que nous devons essayer de saisir, sur laquelle nous devons nous raccrocher, pour avancer. Si petite, si ténue soit-elle, il faut se raccrocher à la luciole, à Sophia.
« Aucun jour n’est mélancolique. », écrit de Duve.
Mais tout cela ne serait rien, si ce n’était pas porté par une écriture, précise, exigeante, poétique, qui touche au plus près le lecteur.
« Elle fait exprès des phrases en virgules, pour exprimer une idée non qui avance non qui désosse, s’augmente ou se précise, mais qui danse, fléchit, se rattrape, s’use, se désoriente, (…). »
Au tableau 32, cette phrase, ce bout de phrase. Et ai l’impression, en y arrivant, en la lisant, en la reprenant, lentement, en m’arrêtant sur « désosse », sur « désoriente », que tout y est, que le livre, est là, tout en entier, dans cette vision quasi-programmatique de l’écriture, de l’écriture comme je la conçois également, de ce qui me plaît le plus : être désorienté. Avoir la tête qui tourne, un peu, comme quand on a trop dansé, quand on est un pu ivre, de mots, de mots choisis (vocabulaire très précis de la botanique) ; ivre de cette avancée de cette femme, des danses de cette femme, Sophia. Qui avance et énonce (peut-être que ces deux verbes sont en fait synonymes), Sophia ce qu’elle est, sa singularité, son être.
Je voudrais rajouter à la fin de cette petite et modeste présentation, que j’ai écrit cet article en écoutant, Anja Lechner, son dernier disque : Bach/Abel/Hume. Chez ECM.
Oui, les lucioles sont là, et dans le soleil de ce début mars, écrire sur Sophia, en relire des pages, des bouts, s’arrêter encore sur cette phrase, « Sophia avait fermé les yeux ; se fait manger par une rose. », écouter Bach, Abel et Hume, oui, on peut se dire que les lucioles sont là, partout autour de nous.
Éléonore de Duve, Sophia, http://www.jose-corti.fr , 88 pages, 16 euros.
Parution le 6 février 2025.
© EMMANUEL REGNIEZ
Mars 2025
