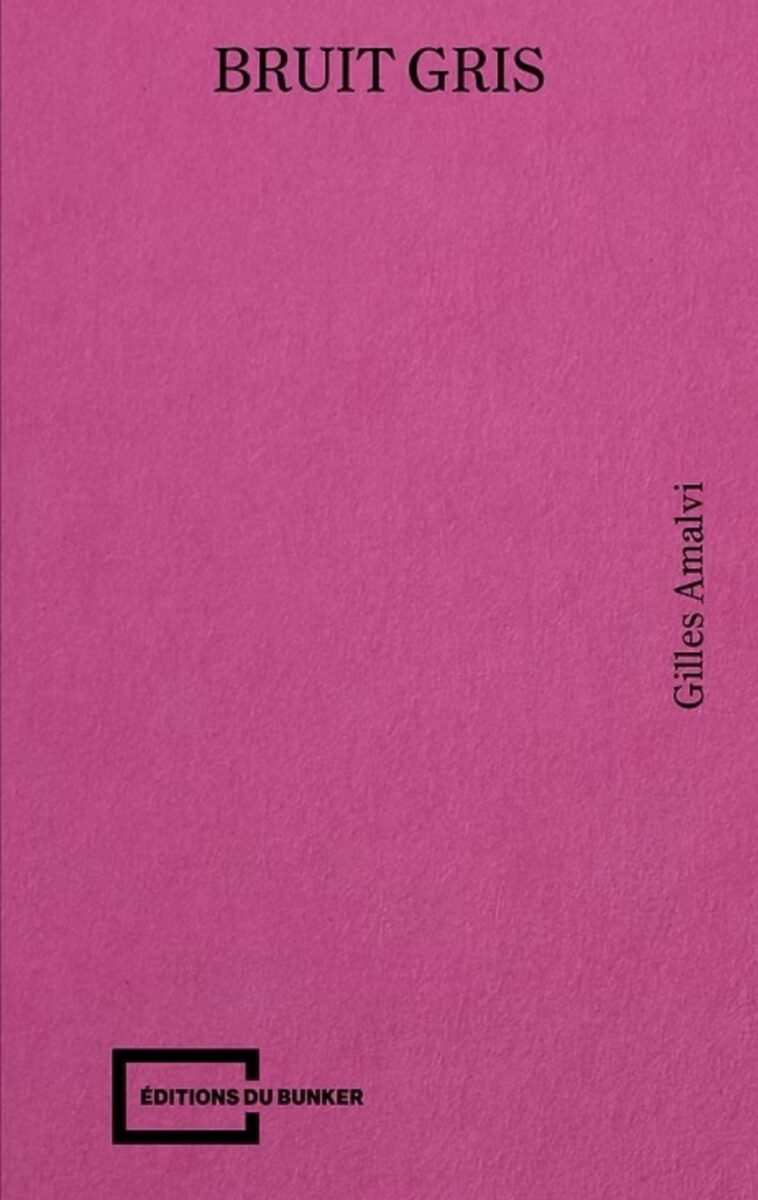
Faire de la poésie un sismographe d’une crise ordinaire
Il ne faut pas se tromper d’angle : Bruit gris n’est pas un livre sur la crise. Il est un sismographe de la crise. Il n’en fait pas le récit, il en capte les vibrations, les secousses diffuses, le bourdonnement continu. Il est écrit depuis elle, depuis ce bruit de fond que nous partageons tous, parfois sans même le reconnaître. La crise, ici, n’est ni un événement ponctuel ni une catastrophe spectaculaire : elle est l’état ordinaire du monde que nous habitons, son régime sonore permanent.
Mais ce sismographe n’est pas froid. Il ne relève pas d’une neutralité technique ou d’un enregistrement désincarné. Il opère selon une tendre lucidité : une attention sans illusion, mais sans dureté, portée à ce qui tremble encore sous l’égalisation générale. Une lucidité qui n’épargne rien mais qui continue d’écouter. Une manière de rester au plus près du réel sans s’en protéger.
D’emblée, le livre prend le lecteur à revers. Le « bruit gris » évoque une neutralité technique, une égalisation froide, une zone sans couleur. Le rose de la couverture vient contredire cette attente. Il introduit une dissonance visuelle, comme le texte introduit une dissonance politique. Le livre annonce : ce que vous allez lire ne correspondra pas à ce que vous croyez entendre, et c’est précisément là que l’expérience commence.
Dès les premières pages, une phrase tombe, sèche, presque ironique :
tu as cru qu’on rigolait ?
Elle pourrait servir d’exergue à l’ensemble. Rien, dans Bruit gris, n’est là pour installer une distance critique confortable. Le texte ne cherche pas à expliquer : il expose, il sature, il martèle. Il avance par blocs, par listes, par reprises, comme si la langue elle-même était prise dans une boucle algorithmique, contrainte de redire le monde autrement pour tenter encore de le saisir.
La politique de Bruit gris se joue précisément là : dans le refus du récit continu. Gilles Amalvi ne raconte pas l’effondrement, il en adopte la logique. Le monde apparaît sous forme de fragments équivalents, interchangeables, nivelés. Tout devient égal : bruit gris égal bruit mort, égal réfrigérateur mort, égal prêt immobilier mort, égal guerre propre mort. Cette syntaxe de l’égalité agit comme une machine critique : elle révèle comment le capitalisme tardif, la technologie, la gestion politique et la consommation produisent un même effet de neutralisation, comme si le monde passait par un sonotone collectif, réglé non pour mieux entendre mais pour ne plus être affecté. Tout se vaut parce que tout a été vidé.
Rien n’explose vraiment. Tout est déjà là, figé, administré, en attente. La crise est lente, continue, presque bureaucratique. Elle s’infiltre partout : dans le restaurant, la plage, le désert, la zone grise. Aucun lieu n’échappe à cette contamination.
La géographie devient politique : elle dessine une cartographie sensible d’un monde où l’espace public, le loisir et l’intime sont atteints du même symptôme.
Dans ce contexte, la poésie n’est plus un ornement ni un refuge. Elle devient un outil d’enregistrement. Gilles Amalvi écrit comme on capte un signal, comme on écoute une radio mal réglée mais obstinée. D’où ces phrases isolées, ces pages presque blanches, ces mots laissés seuls au centre, à droite, en bas, non comme des effets, mais comme des traces.
Le blanc n’est pas un silence poétique : c’est un vide politique, l’espace laissé par un discours qui s’est retiré.
Bruit gris est un texte qui assume la faillite du politique traditionnel.
À la question « que reste-t-il ? », la réponse demeure volontairement fragile :
rien n’aura eu lieu
que le non-lieu
excepté peut-être
une déflagration
La déflagration ne se montre pas, elle est annoncée, pressentie puis différée. Elle existe comme possibilité, comme menace, comme désir collectif. Là encore, la crise n’aboutit pas : elle persiste.
Lire Bruit gris, c’est accepter une position inconfortable mais partagée. Celle d’un lecteur plongé dans un bruit qu’il croyait extérieur et qui découvre qu’il en fait déjà partie. Le texte ne dénonce pas : il implique.
Il rappelle que nous sommes des auditeurs saturés, des corps traversés par des flux mais aussi des lecteurs encore capables d’écoute.
Ce recueil offre ainsi une lucidité sonore, attentive, tenue. Une lucidité qui n’écrase pas ce qu’elle observe et qui ne s’abrite pas derrière le cynisme. Il prend acte de la crise comme condition durable et de la poésie comme l’un des derniers lieux où cette crise peut encore être entendue, ensemble.
Gilles Amalvi, Bruit gris, Les Éditions du Bunker, parution le 9 décembre 2025, 180 pages, 18 €.
https://www.editionsdubunker.com
©SOPHIE CARMONA
Janvier 2026
