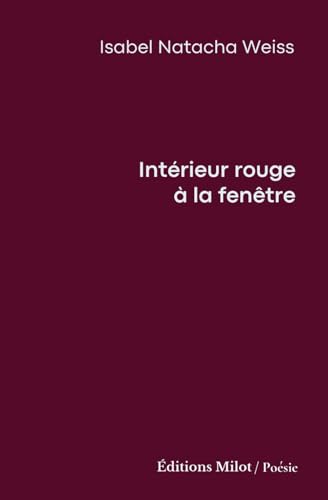
Isabel Natacha Weiss est d’origine allemande du côté paternel. Après des études de lettres et de philosophie, elle se consacre à la recherche, à la poésie et au langage et publie plusieurs ouvrages, sur la pensée d’Hegel notamment. En 2020, elle décide d’orienter son travail vers une forme plus libre d’écriture alliant réflexions philosophiques et textes poétiques. Intérieur rouge à la fenêtre est son dernier ouvrage publié aux éditions Milot.
Pour saisir ce livre, il faut entrer dans cet intérieur nappé de cette couleur audacieuse. Tourner la page équivaut à en ouvrir la porte pour pénétrer dans l’intimité des mots offerts aux lecteurs. Le livre devient l’espace clos, tamisé par le rouge enveloppant, mais ouvert sur le monde par la fenêtre promise. Une fenêtre comme un tableau changeant, en perpétuelle mutation qui se ferait métaphore de la réflexion.
L’auteure rédige un recueil faisant se rencontrer la philosophie et la poésie où les concepts font narration et les ambiances forment un récit charnel. Par conséquent, le beau, le temps, le corps sont autant d’acteurs animés sous la plume de l’auteure. Critique d’un monde tranchant.
LE BEAU
Le titre du recueil n’est pas sans évoquer la toile d’Henri Matisse, Intérieur rouge, nature morte sur table bleue réalisée en 1947. L’espace est rouge nervuré d’épais traits noirs. Au premier plan, un table bleue garnie d’un bouquet et de quelques fruits rouges également. Sur le fond, se détache partiellement une fenêtre ouverte sur un jardin. L’absence de perspective désoriente le regard qui se voit pris d’intérêt à la fois pour ce premier plan et pour le dernier.
Au printemps de l’année suivante, le peintre réalise à la Villa le Rêve Grand intérieur rouge. On y discerne également, posés sur deux tables dont une ronde en fer forgé, l’autre rectangulaire en bois rouge, différents vases qui accueillent des bouquets de tulipes et de jonquilles. Au mur, nous pouvons percevoir deux grandes toiles. Celle de gauche est en noir et blanc et représente un espace indéfini, une table circulaire sur laquelle un vase et un bouquet fleuri sont posés. Un écho s’effectue, l’artiste crée une ressemblance redoutable entre la fiction peinte présentée comme réelle et la fiction dans la fiction. L’intérieur à l’intérieur. À droite, une deuxième toile, très différente dans les choix chromatiques opérés. La couleur jaillit, elle est vive. Cependant, si l’orangé et le rouge dominent, l’ensemble se fond dans le décor comme si Matisse désirait créer, une seconde fois, une confusion entre le vrai et le faux. Un rêve éveillé dans l’intimité de cet intérieur rouge.
L’intérieur est cet environnement fermé ambivalent. Il peut être une prison aseptisée, la chambre familière de Xavier de Maistre où les dérives de l’esprit sont maîtresses ou l’intériorité riche et créative de Frida Kahlo. Matériel ou symbolique, réconfortant ou étouffant, l’intérieur devient un monde aussi vaste qu’étriqué enfermant un infini de possibles ; enrichi par la fenêtre synonyme d’ouverture, d’espace déployé. Par elle, l’air s’invite, s’engouffre et devient parent de la vie, de la liberté. Il anime le corps en s’infiltrant à l’intérieur de cet autre espace rouge et clos que constitue l’enveloppe de chair, le fait respirer, gémir d’un souffle tenace.
Le rouge, communément symbole fondamental du principe de vie, est cette couleur énigmatique et complexe. Il est le feu, le sang, le cinéma, tonique et passionné, la transgression, l’interdit, le danger, sexuel et sacré, incarnant selon sa densité, l’homme ou la femme, le diurne ou le nocturne. Il se fait cycle, naissance et mort, blessure et puberté ; étroitement lié au corps.
Personnage à part entière, le rouge se développe tout au long de l’ouvrage, se démultipliant au gré des situations, évoluant en carmin, en brique, sang, pâle, brillant, viande, il habille les bottes, colore les serviettes et les monokinis ou trace les lèvres. Il se fait compagnon d’écriture, donnant une tonalité viscérale aux propos rédigés ; parfois dans une mise en abyme du discours :
« Arrivés à cette limite où il faut chercher la beauté, englués dans ce préjugé qui traîne, la beauté qui moins dans l’œuvre que dans le discours sur elle : c’est cette lecture, intelligente et concertée, qui donne aux éléments si arbitraires, si hors de propos, aussi dissous et indifférents que les grains de sable d’une pâte brisée, si hétérogènes les uns des autres, la nécessité comme autre préjugé de l’œuvre d’art. Ce discours est comme un ciment. Il est quelque chose, une matière solide et solidifiant, un stereos, elle colle et soude des morceaux de lego qui ne s’emboîtent plus les uns dans les autres, spontanément. » [1]
Le discours, ici critiqué, cousu de fils rouges pour maquiller l’absence, emprunte la cadence d’une marche soutenue. Un rouge de théâtre où les coutures de l’œuvre, auparavant cachées, sont exhibées par les mots pour justifier la légitimité. Ce que l’auteure appelle le subjectivisme moderne. De fait, les mots qui font discours prennent une couleur grâce à la temporalité à laquelle ils sont rattachés. Le temps du discours. Le rythme de celui-ci.
LE TEMPS
Isabel Natacha Weiss interroge ce concept omniprésent à travers différentes et singulières notions : l’absence, l’habitude, le souffle. L’avant et l’après comme autant d’entrées et de sorties dans cet intérieur rouge, comme autant d’allers-retours mentaux dans le labyrinthe de nos réflexions. Le temps, tantôt lent, tantôt insaisissable, prend forme dans une inspiration, dans une marche où le silence tiède enveloppe le corps, dans une nuit caressante, dans un rêve qui s’efface, dans la musique entendue de la mer, dans une marque sur le visage, un parfum. L’auteure écrit l’élasticité du temps ainsi que le sens que l’on apporte à ces détails de la vie et à la mémoire qui fait durer la fugacité d’un instant. De fait, les couleurs et les odeurs, les sonorités et les textures construisent la poésie et les plaisirs vivants. Le passé s’offre au présent à l’image des vagues qui toujours respirent :
« L’anneau autour du cou,
Ou l’anneau des princesses vengeresses,
Ou l’anneau de l’éternel retour,
En lui toutes les décisions.
Laisser le temps prendre le large,
Te donner du champ, des péripéties, hmm, tout te tente,
Tout ce que tu crois avoir vécu qui revient pour la première fois,
Les rêves au visage de vieillerie
Ces armoires du passé en supporter l’odeur
L’orage a cessé
Les wagons se vident peu à peu,
On va vers l’est
(allongé sur le ventre tu ne sais pas si le train avance ou recule)
Ça te grise un moment. » [2]
LE CORPS
S’il existe en tant que matière, il s’anime aussi par l’esprit qui le contrôle et le dresse. Le corps doit être exercé, manipulé, touché pour sentir l’énergie qui le lie au monde. L’art, la danse notamment, transcende cette relation du corps à l’espace et du corps à la vie. Il renait par l’effort et dans celui-ci. Il intègre son environnement dans sa manière d’exister et traduit la lenteur et la vitesse, le mou et le dur, la souplesse et la rigidité, le petit et le grand, le passé et le futur, le présent et l’absent. C’est dans sa fragmentation qu’il se dessine et de ce dessin naît la beauté. Les coutures, précédemment évoquées, d’une œuvre se dérobent laissant apparaître l’essence de l’art. Ainsi se demande-t-elle « Où se déplacent ces corps malmenés, que vont-ils former, que vont-ils reconstituer ? » [3], suggérant alors un changement de paradigme, un bouleversement du regard.
Le rapport au corps, et plus généralement le rapport au monde, est un jeu de miroirs, un basculement des observations. « Tout ce que tu es, et fus, et seras, il en est l’écho tactile, son masque est ton maquillage, jouet de tes doigts vifs, caressant et modelant les crevasses, les rainures, les plis du visage de ce monde-là. » [4]
« Le monde que je désire est le monde que je vois. » [5]
En somme, à travers plusieurs récits, Isabel Natacha Weiss écrit l’humain dans sa dimension charnelle et sensible et dans sa relation au monde, invitant parfois le lecteur à profiter de l’absence pour mieux saisir le pathos philosophique. Elle raconte la souffrance et la passion du corps et de l’esprit qui, à l’image des intérieurs d’Henri Matisse, évoluent dans un réalisme reconstruit. Le reflété et le reflétant, le regardé et le regardant se confondent. Elle convoque les sens du lecteur et fait de son livre un texte liquide composé de matières, de visuels et d’odeurs :
« Toute cette toison si chaude et si odorante, par tous les poils de sa robe, mouvant sous la main, ondulant à la limite et dans cette caresse toute sa beauté. Ses sabots posés sur la terre noire la réchauffent à chaque pas, léger et assuré il est chez lui, c’est pourquoi il est grand. En aimant ainsi cette fourrure tiède lui revient en mémoire que la caresse est un goût, que la peau respire respire et absorbe, qu’elle sent et qu’elle avale, que le goût et le parfum sont le toucher véritable. » [6]
Intérieur rouge à la fenêtre, Isabel Natacha WEISS. Éditions MILOT. 79 pages. 15 €
9 février 2025
© DAVID VALENTIN
Relecture : Gwénaëlle FOLL
[1] Isabel Natacha WEISS, Intérieur rouge à la fenêtre. Édition Milot, Poésie. p.39
[2] Ibid. p.34
[3] Ibid p.49
[4] Ibid. p.51
[5] Ibid. p.51
[6] Ibid.p.52
