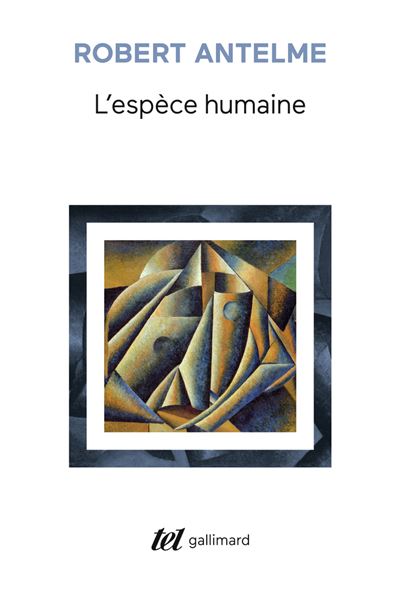
En mai 1944, à vingt-sept ans, le résistant Robert Antelme (1917-1990) est arrêté par la Gestapo puis déporté à Fresnes, Buchenwald et Gandersheim. En 1945, il échoue à Dachau où deux amis le retrouvent affaibli à l’extrême et le ramènent à Paris. Robert Antelme écrivit dès son retour, en 46 et 47, L’Espèce humaine — dédié à Marie Louise, sa sœur morte en déportation — qui sera publié en 1947.
Ce texte majeur est consacré à l’expérience indicible de l’homme réduit à l’extrême dénuement du besoin. Témoignage bouleversant, au même titre que ceux de Georges Hivernaud ou de Primo Levi. Marguerite Duras, qui fut son épouse de 1936 à 1947, relatera le retour de son mari des camps, dans La Douleur, publié bien plus tard, en 1985.
L’Espèce humaine est un livre exceptionnel, tant par la maîtrise indépassable dans le récit que dans la pudeur des notations les plus poignantes. A-t-on encore besoin d’un tel livre pour faire taire négationnistes et révisionnistes de tous bords ? Oui.
Robert Antelme résume la double difficulté à laquelle se heurte son discours de survivant : celle d’exprimer une expérience tellement chargée émotionnellement qu’elle lui coupe littéralement le souffle ; celle de transmettre au public quelque chose qui est tellement en-dehors de la norme, que sa plausibilité paraît problématique au sujet même qui vient de réintégrer le monde.
Il ne s’agit donc pas seulement de dire l’indicible, mais aussi du problème de communiquer avec celui qui n’a pas connu l’univers concentrationnaire. C’est en vue de rendre un réel à la fois existant et invraisemblable, effectivement vécu et inimaginable, c’est pour suggérer une souffrance et une monstruosité qui ne peuvent se transmettre, que Robert Antelme use d’un style nu fait de raccourcis et de juxtapositions.
La syntaxe est réduite à sa plus simple expression, dépouillée de subordonnées et axée sur la juxtaposition. L’alternance, du on, du nous et du je, sert à prouver que tous les détenus subissent le même sort. Plus qu’à la dépersonnalisation, le système concentrationnaire vise à la déshumanisation. « Leur fureur était leur lucidité ; notre horreur, notre stupeur étaient la nôtre. »
Si le témoin a droit à la parole, ce n’est pas seulement parce qu’il a vécu dans son corps et son esprit la condition des détenus, c’est aussi parce qu’il projette dans son récit celui qui, dans la souffrance la plus extrême, n’a pas trahi. « C’est ici qu’on aura connu les estimes les plus entières et les mépris les plus définitifs, l’amour de l’homme et l’horreur de lui dans une certitude plus totale que jamais ailleurs. »
Robert Antelme se livre donc à une minutieuse remémoration, à une analyse et une réflexion sur la déportation qu’il a connue dans les camps de concentration et d’extermination nazis. Taraudé par la faim, le froid, les poux, le travail forcé et inhumain, la maladie, l’extrême faiblesse, le témoin explique comment lutter, survivre.
Quand l’homme en est réduit à l’extrême dénuement, le besoin se radicalise au sens propre, il n’est plus qu’un besoin sans contenu, le rapport nu à la vie nue et le pain répond immédiatement à l’exigence de vivre. Il s’agit d’un égoïsme sans ego où l’homme, acharné à survivre, porte un attachement impersonnel à la vie. On comprend alors combien
Vivre devient sacré. « Il ne faut pas mourir, c’est ici l’objectif véritable de la bataille. Parce que chaque mort est une victoire du SS. » Dans l’être humain réduit à un corps méconnaissable se marque la primauté absolue de la sensation, au plus près de la situation vécue, avec son cortège d’angoisse, de honte, de dégoût, de désir de vengeance. Mais ce sont les sensations brutes qui l’emportent, et le discours se concentre sur la notation du froid, de la fatigue et, bien sûr, l’obsession de la faim. Robert Antelme analyse les attitudes, débusque l’unicité et l’indivisibilité, déniche l’humanité sous la boue. Elle se rassemble dans son champ de perception et il enregistre les ondes émises par la haine, les regards, la menace de mort constante, la vanité nazie, l’orgueil des SS, la morgue satisfaite, repue d’elle-même, l’avidité que développe le goût du pouvoir sur autrui.
Tous ces instants d’une insoutenable densité pour faire entendre ce que furent ces espaces de négation de l’autre, de destruction physique et morale, ce temps de mépris, de haine, de bassesse et pourtant de courage aussi, pour certains, à faire de leur vie intérieure une résistance noble, une force de bonté.
© Pascale Arguedas
Robert Antelme, L’espèce humaine, Éditions Gallimard, collection « Tel ».
