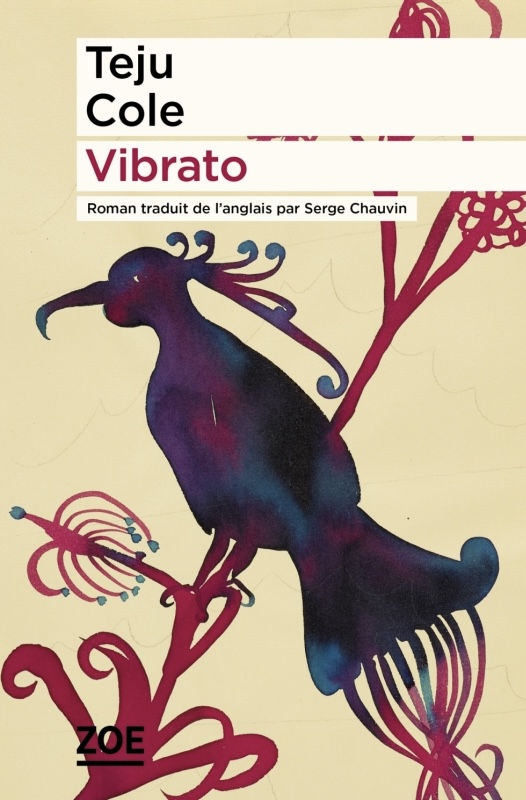
Dans Vibrato, Teju Cole cite plusieurs fois le film d’Ingmar Bergman Les Communiants pour évoquer la difficulté de ses personnages à mener leur vie tout en supportant la douleur du monde qui les entoure, un monde construit en grande partie sur des drames, en particulier ceux vécus par les peuples détruits ou asservis pour assurer la puissance d’un État occupant : les Indiens d’Amérique, les aborigènes d’Australie, beaucoup de peuples des pays d’Afrique, car c’est de ce continent qu’est originaire Teju Cole. Cette liste n’est pas exhaustive, on le sait.
C’est à cela que Teju Cole nous convie, à une promenade mélancolique à la manière de Virginia Woolf, avec son alter ego, Tunde, professeur de photographie à Harvard, d’origine nigériane, mélomane et amateur d’art : Tunde questionne notre rapport au monde par le prisme de l’art, la musique, les appropriations culturelles, nos préjugés d’occidentaux, le racisme bien sûr, le voyage, et, finalement, notre responsabilité face aux événements et notre place dans le monde.
La responsabilité, oui, car Vibrato c’est la vibration du monde, la musique du monde qui nous parvient, de près, de loin, c’est un voyage, un récit érudit et foisonnant autour du globe, un récit sur la conscience de ce qui nous entoure, l’expérience et la tessiture de la vie, les pertes des peuples, l’insécurité, la dépossession, les histoires collectives brisées, et nos pertes personnelles, ici passe le souffle d’une amitié perdue.
Tunde est ultrasensible, amateur d’art, esthète, cultivé : l’art est pour lui l’instrument de son exploration, une clef de compréhension du monde. L’art est représentation, mais également, par sa beauté, consolation, protection, sublimation : mais voilà, il faut aimer la beauté sans occulter la vérité.
Qu’est-ce qui donne de la valeur à un objet rapporté du bout du monde, et au même objet trouvé dans une brocante du Massachusetts ? Où se niche la vérité derrière les grands tableaux historiques, comment photographier les habitants des pays que l’on traverse sans en faire une représentation simplement pittoresque et esthétisante ? Autant de points de vue qui ramènent à la question du pouvoir des uns et de l’assujettissement des autres dans ces représentations. Finalement, comment montrer le monde avec compassion ? Derrière la beauté des œuvres, comment appréhender la multitude des images : les visages qui nous parviennent, les tableaux dans les musées, les photos dans les galeries d’art, quelle est la vérité d’une représentation ?
La littérature pose les mêmes questions, elle est comme le voyage, elle est voyage, nous traversons les époques, les continents, les expériences, et nous remettons en perspective notre petit univers personnel : nous pouvons aller vers l’autre, avec humilité, en alerte, aux aguets, en conscience, être présents, chercher derrière les apparences, ne pas nous en tenir aux discours officiels, et nous questionner. La littérature devient alors, au-delà d’un élan de vie et d’amour, une vigie, une résistance. La littérature, c’est la possibilité de la vérité.
C’est ce que les Anglo-saxons ont toujours su faire, je ne dirais pas mieux que nous, mais malgré tout, un témoignage tourné vers le monde, ample, avec des auteurs comme Russel Banks, James Baldwin, ou près de nous Chimamanda Ngozi Adichie, nigériane comme Teju Cole. Ou quand nos petites histoires croisent la grande Histoire. J’ai toujours aimé cette littérature-là, une tresse faite de nos vies personnelles croisées avec les événements du monde, car, particulièrement en ce moment, nous ne pouvons envisager nos vies futures sans tenir compte des bouleversements mondiaux à l’œuvre. C’est ce que font aussi les écrivains d’Afrique du Sud, John Maxwell Coetzee, ou Damon Galgut avec son roman troublant La Promesse, l’histoire d’une famille sur plusieurs décennies, dans un pays qui essaie de panser les plaies laissées par l’apartheid.
Et derrière le bruissement incessant du vibrato, Teju Cole, doucement, avec délicatesse, tendresse, nous rappelle qu’il y a aussi la vie, nos vies, nos vies ordinaires. Comme celle de Tunde, ses souvenirs d’enfance au Nigeria, sa vie aux États-Unis avec un amour, complexe mais sincère, cette amitié enfuie, un deuil, la photographie, le temps qui passe, l’absence d’enfant, et la musique, toujours, John Coltrane, son idole.
Il nous dit qu’il existe la possibilité d’un apaisement que la littérature, l’art et la musique peuvent procurer, si nous restons, malgré nos grandes tragédies collectives, malgré les drames intimes, sur le qui-vive, à la recherche de la vérité, au plus près du réel, sincères, et au plus près de nos rêves, aussi, et j’ai envie d’y croire.
© CAMILLE JALLADE
VIBRATO, Teju Cole, https://editionszoe.ch , 256 pages, 22 €
