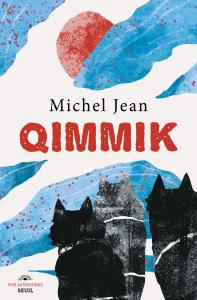
Sur ce continent, longtemps oublié, les humains vivent avec leurs qimmiit, leurs chiens. Des chiens gros, forts, résistants et fidèles.
Depuis cinq mille ans, l’inuktitut et le jappement des qimmiit résonnent dans le Nunavik. La vie est cruelle. Mais c’est ce qui la rend belle. Précieuse.
Nunavik, au Nord du Québec, territoire où vivaient autrefois les Inuit et les Cris, deux peuples autochtones.
Au cœur des terres âpres et belles, ce récit nous emmène aux côtés des Inuit, lorsqu’ils parcouraient encore l’immensité blanche sur leurs traîneaux tirés par leurs chiens, leurs qimmiit.
Immersion dans leur culture et leur mode de vie, cette histoire nous raconte une époque révolue.
Tout a basculé il y a quelques décennies, lors de la « rafle des années 1960 » lorsque les allochtones ont décidé de sédentariser ce peuple autochtone.
Avant cet épisode, ils vivaient libres, nomades, au rythme des saisons et de la nature.
Ce roman, à la double temporalité, raconte les ravages perpétrés par l’homme blanc, mais il rend surtout hommage aux Inuit ; il leur donne voix, de la plus belle manière qui soit, en racontant le quotidien qui était le leur.
Je suis née à Kuujjuaraapik, à la limite de la toundra et de la taïga. L’embouchure de la rivière marque la fin d’un monde et le début d’un autre. Inuit et Cris vivent voisins et on passe sans s’en rendre compte de Kuujjuaraapik à Whapmagoostui. À moins d’être d’ici, on ne voit pas que les maisons, les gens, leur manière de s’habiller, les rues, tout raconte une autre histoire. Le peuple cri est tourné vers les rivières et l’intérieur des terres et la forêt, le peuple inuit, vers la mer. Les gens du Sud se demandent souvent pourquoi nous vivons au Nord, où la vie est plus difficile. Mais les Inuit appartiennent à ce territoire. Nous n’en connaissons pas d’autres. N’en espérons pas d’autres.
C’est chez nous.
Passé, présent ; dans le passé, il y a Saullu, cette jeune femme née à Kuujjuaraapik, celle qui nous transmet l’héritage inuit ; dans le présent il y a Ève, jeune avocate du prestigieux cabinet Goldstein, Dawn et Poliquin, chargée de défendre un Inuk accusé de meurtre.
On dit « un Inuk », « deux Inuuk ». « Inuit » est le pluriel pour trois et plus. Sans S.
Présent, passé ; les temporalités s’entremêlent d’un chapitre à l’autre, ce qui nous permet de mieux prendre conscience de l’impact de l’homme blanc sur la vie du peuple inuit.
Quand les gouvernements canadien et québécois ont commencé à faire sentir leur présence dans le Nord, cela a signifié la fin de près de cinq mille ans de vie nomade pour les descendants des anciens peuples Thulé. À partir des années 1950, les gouvernements ont commencé à les regrouper de force dans les villages, ce qui a sonné le glas de leur mode de vie traditionnel.
Ces femmes et ces hommes vivaient en parfaite harmonie avec leurs chiens qui faisaient partie intégrante de leurs vies, de leurs familles même. Leur quotidien était rythmé par la chasse, la confection de leurs habits en peaux de bêtes, la construction de leur habitat quand ils se déplaçaient pour les besoins de la pêche, de l’affût ou de la saison.
Leurs chiens étaient leurs compagnons, leurs alliés, leurs guides même dans certaines situations, car les qimmiit sont capables de repérer les dangers sur la glace mais aussi les trous de respiration des phoques, ce qui est un atout majeur pour la chasse. Ils sont également endurants et courageux lors des déplacements à traîneau.
Vingt chiens. Vingt cœurs fidèles et courageux me ramènent chez moi, sur la côte. Le bruit de leurs pas résonne dans l’air froid et bat la cadence. C’est la musique des Inuit.
Au diapason de la beauté de cette relation homme-chien vibre également la magnificence de la nature environnante : lumineuse, pure, sauvage. L’auteur décrit avec passion des paysages époustouflants où la main de l’homme n’a pas encore détruit, pillé, plié à sa volonté.
Une bourrasque venue du nord nous pousse dans le dos et dissipe soudain le nuage. Apparaît alors dans la lumière nue un spectacle stupéfiant.
Une mer, vivante et grouillante. Cinq mille ? Huit mille ? Dix mille caribous les bois au vent ? Combien de cœurs battent au même rythme devant moi ? Aucun autre animal sur terre, à part les humains peut-être, ne ressent le besoin de vivre en communauté nombreuse au sein d’une nature austère. Ce troupeau parcourt la toundra depuis la nuit des temps. Ce territoire est le sien.
Les chiens se sont arrêtés, subjugués eux aussi par l’apparition des caribous, qui grattent le sol et mangent en avançant.
Il y a une poésie folle qui se dégage de ces instants suspendus, une poésie irréelle, naturelle, un charme incroyable qui envoûte et enchante à la fois.
L’auteur ne se contente pas de raconter, il plonge le lecteur au cœur de l’histoire, dans une aventure sauvage.
L’immersion se fait également au niveau de la culture, car un savoir important est transmis tout au long du récit.
Innus. Inuit. Les mots se ressemblent, et pourtant ils désignent des peuples qui ne pourraient être plus différents. Les ancêtres des Innus sont arrivés en Amérique il y a dix mille ans. Leur langue, leur culture ressemblent à celles des Atikamekw à l’est, des Cris et des Naskapis au nord. Ils ont des parents jusqu’en Terre de Feu, dans tous ces peuples autochtones qui, les premiers, ont habité le continent.
Les ancêtres des Inuit sont arrivés en Alaska il y a environ cinq mille ans. Certains ont migré plus tard vers l’est et occupent maintenant l’Arctique jusqu’au Groenland, un territoire de plus de six mille kilomètres où règne une seule langue, l’inuktitut. Leurs frères vivent au Groenland, en Russie, et ils ont des liens avec les Samis en Suède, en Finlande et en Norvège. Ces peuples nordiques demeurent autour du cercle polaire sur un territoire à la fois riche et ingrat. Ils ont créé des outils pour chasser les baleines, les phoques et le caribou. Ils ont inventé l’igloo. Leur histoire est une leçon d’adaptation et de résilience. Les gens du Sud leur ont imposé leur propre notion du progrès et, aujourd’hui, ils en sont réduits à habiter des villages isolés, dans un désœuvrement qui fait honte à nos sociétés.
Nos sociétés, l’homme blanc… À partir de 1950 débute ce qui fut appelé « la rafle des années 1960 », l’assimilation des autochtones par la sédentarisation, l’envoi des enfants en pensionnat où ils étaient forcés de renoncer à leur langue, à leur culture, à leurs racines sous peine de sévices. Combien d’enfants sont morts dans ces pensionnats, sordides et inhumains ? Il y eut aussi les vols de bébés pour les confier à des familles allochtones sous prétexte que les familles autochtones n’étaient pas capables de les élever correctement.
Ces alertes survenaient lorsque les services de protection de l’enfance considéraient un futur parent comme représentant un haut risque et donc comme étant incapable de s’occuper de son enfant. Celui-ci était alors retiré de sa famille dans les heures qui suivaient la naissance. Les fonctionnaires débarquaient et emportaient parfois de force les nouveau-nés aux parents qui s’y opposaient. Les bébés se retrouvaient alors dans le système de protection de l’enfance ou placés en adoption dans des familles allochtones.
Et tout ceci a commencé il y a à peine plus de cinquante ans ! Est-ce seulement imaginable ? concevable ?
Il nous fallait un tel récit pour nous rappeler les désastres perpétrés par l’homme blanc ici, au Nunavik, ou ailleurs également.
L’homme blanc n’a de cesse d’asservir et de dominer, de modeler le monde à son image et à sa ressemblance. Peu importe ce qu’il en coûte.
Il était une fois le peuple inuit et ses qimmiit…

Michel Jean, Qimmik, Éditions du Seuil, parution le 11 avril 2025, 216 pages, 20 €.
https://www.seuil.com/ouvrage/qimmik-michel-jean/9782021583632
© CHARLOTTE LEBECQ @read_to_be_wild
Correction : Julie Poirier @correctrice_point_final
