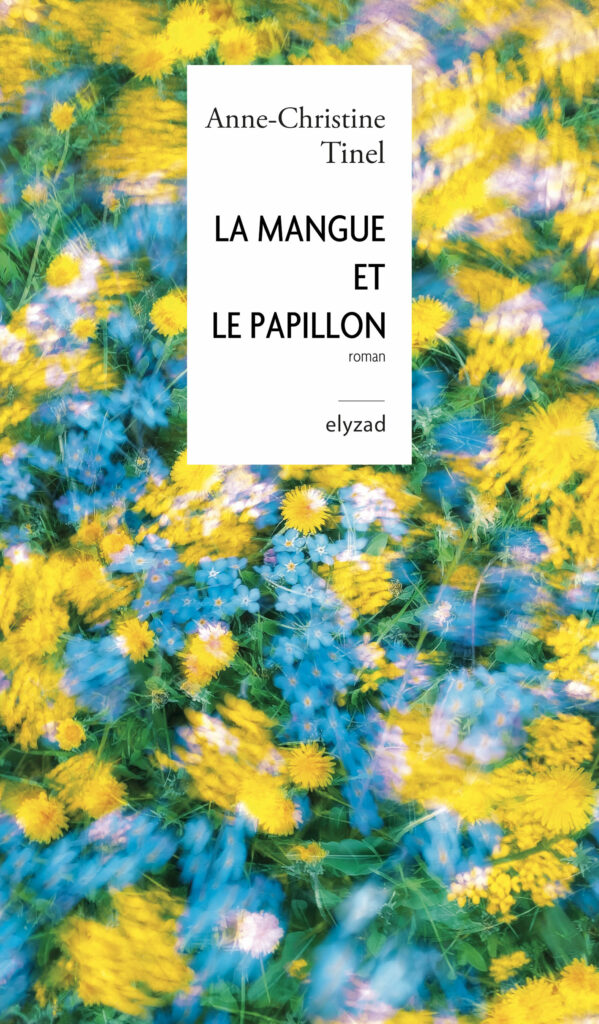
J’aime beaucoup cette affirmation du logicien polonais Alfred Tarski : « La neige est blanche » est vrai si et seulement si la neige est blanche.
Et je la pense toujours ainsi cette affirmation du logicien polonais Alfred Tarski : « La neige est blanche » est vrai si et seulement je dis que la neige est blanche.
Dire et cela devient. Avant de le dire la neige n’est pas blanche, elle est juste de la neige. Avant de le dire les choses ne seraient pas, ou pas vraiment, ou pas encore. Ou juste elles sont dans une extrême évidence. Une évidence qui n’a pas besoin d’être dite. Et en le disant soudain s’ouvre un abîme. Oui, la neige est blanche, et elle ne l’est pas, elle ne l’est pas toujours. Et l’évidence ne l’est plus. Parce que quelque chose a été dit.
Et pour moi, lecteur, c’est là aussi que se joue la littérature que j’aime et qui m’intéresse (ce qui ne veut pas dire qu’elle est la seule et ne veux mettre en étalon mes goûts), dans cette capacité à désigner et nommer le monde, évident, pour en faire ressortir toute l’ambivalence. La littérature doit aussi remettre en bouscule le monde, doit toujours bousculer le monde.
Dans ce beau roman d’Anne-Christine Tinel[1], La Mangue et le papillon, deux phrases importantes, reprises en quatrième de couverture, m’interpellent tout particulièrement : « Le mot jeté en travers du chemin possède une force. Le mot a pourfendu le monde en deux blocs distincts. »
Le mot qui peut pourfendre le monde, en deux blocs, qui peut couper le monde, qui peut séparer ; un mot prononcé qui peut soudain tout séparer. Avant le monde était un, et il l’est pour les enfants, et puis quelqu’un, un adulte le plus souvent, le mot d’un adulte, qui vient créer une séparation, qui vient créer une rupture, qui va devenir réalité. Lucie est noire, Claire est blanche. Et même si Claire essaye de faire mentir le mot, de le tordre, d’aller au plus près du réel, le mal est fait. « Car si Lucie est noire, Claire est blanche. Or, force est de constater, à observer de près la géographie de sa peau, rugosité grise du genou, bleu violacé des cernes, bras et molles brunis, sans compter la rougeur traitresse montée comme le lait sur le gaz à tout instant, si ce n’est et encore contorsionnée dans le miroir de la salle de bain, la peau des fesses – quoiqu’elle tourne davantage vers le beige -, blanche, Claire l’est aussi peu que Lucie est noire. »
Et pourtant, le mot est jeté, Lucie est noire et Claire et blanche. Et maintenant que cela est nommé, le monde est séparé. Il y a d’un côté Lucie, noire, et de l’autre Claire, blanche. Claire et ses parents. Claire et tous les habitants du village, de la région.
L’histoire est simple, Lucie, jeune fille, s’occupe de Claire, de sept ans sa cadette. Claire aime Lucie comme sa grande-sœur, et un jour Lucie va disparaître, ne plus être là. Claire, avec la disparition de Lucie va connaître la séparation, et comme une chute, qu’elle devra surmonter en essayant de comprendre d’où vient Lucie, et où et pourquoi elle a disparu.
Anne-Christine Tinel pointe, dans ce court roman d’une centaine de pages, un moment sombre et peu connu de l’histoire de France. Ce moment où furent amenés, de force, des enfants réunionnais en France, où ces enfants furent placés dans des familles d’accueil, comme celle de Claire dans le roman, et où ils furent ensuite laissés à leur sort.
Ce roman, tout en finesse et en intelligence, parle de cette violence, de ce moment absurde de l’Histoire de France, de « cette politique de la France, censée lutter contre la pauvreté de l’île et donner une chance théorique à des enfants réunionnais, de s’élever socialement. On a conçu un dispositif de vases communicants, on a déplacé dans la campagne, en métropole où faisait défaut la jeunesse pour venir à bout des foins et de la traite, ceux, trop nombreux là-bas pour le labeur. »
Anne-Christine Tinel joue subtilement avec la fiction, l’histoire de Lucie et Claire, et avec la réalité, cette réalité des enfants déplacés. De cette volonté d’assimilation et de ce que fit alors le gouvernement français pour les intégrer de force dans un paysage qui n’était pas le leur. De ce que fit aussi le gouvernement Français pour les empêcher, ces enfants, ensuite adultes, de se retrouver en communauté, en « ghetto » dira l’assistante sociale de la DASS à Claire qui mène son enquête au début des années 2000. On dispersait ces enfants « dans l’espoir d’un champ pour demain. »
On pense au livre de Didier Daeninckx, Cannibale, qui aussi pointait une partie sombre, très sombre, de l’Histoire de France, de ce qu’elle fit des et avec les Kanaks de Nouvelle-Calédonie.
Deux petits mots sur les éditions Elyzad, fondées en 2005 par Elisabeth Daldoul, qui publient des textes singuliers, avec la volonté de « découvrir l’Autre dans sa singularité, dans son universalité, combattre les préjugés, faire entendre les battements du cœur du Monde. Avec toujours la même exigence, des textes garants d’une pensée libre… ». Née à Tunis, cette maison d’édition depuis maintenant 20 ans propose un passage du Sud au Nord. Edition soignée de textes à la beauté envoutante. Elisabeth Daldoul sait ce qu’est la censure et l’importance des mots et des idées. Elle a fait connaître des textes singuliers, qui sont autant d’ouvertures à des univers étrangers, autres, peu connus, voire inconnus. Il s’agit pour cette maison d’édition, de mettre avant tout en avant des voix. Deux petits mots seulement, alors qu’il en faudrait beaucoup plus pour louer le travail d’Elisabeth Daldoul, pour louer le travail de ce que l’on appelle injustement des « petits » éditeurs.
Anne-Christine Tinel, La mangue et le papillon, 108 pages, parution le 28 mai 2025, 14.50 euros
La maison d’édition
© EMMANUEL RÉGNIEZ
[1] Anne-Christine Tinel a publié chez Elyzad quatre livres : Tunis, par hasard ; L’œil postiche de la statue kongo ; Malena, c’est ton nom et aujourd’hui La mangue et le papillon. Anne-Christine Tinel est aussi autrice de théâtre et a, à son actif, plusieurs pièces jouées, dont : Fartlek, éditions Koinè, La mer n’a pas d’horizon, Editions de Vallières cahier 22

Un texte d’une poignante sobriété qui relate subtilement ce drame des enfants déportes puis abandonnés à leur propre sort.