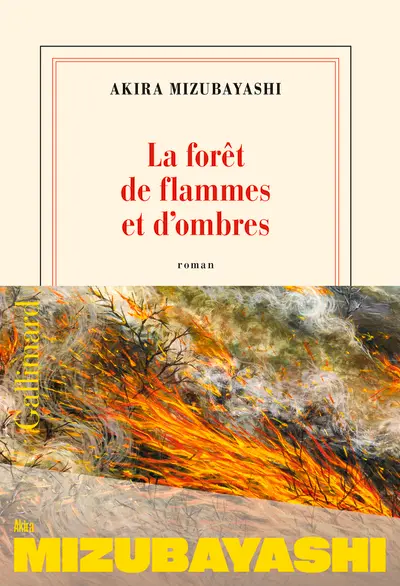
Dans chacune des œuvres d’Akira Mizubayashi, un point d’incandescence affleure comme une manière de faire naître la lumière au cœur même des ténèbres. La forêt de flammes et d’ombres n’échappe pas à ce geste : c’est un roman de guerre qui refuse la guerre, un roman de blessures qui s’obstine à peindre, un roman de silences où la musique persiste à vibrer.
Nous sommes à Tokyo, en décembre 1944. Ren Mizuki, jeune étudiant, trie le courrier dans un centre postal. Il y croise Yuki, peintre en devenir, et Bin, violoniste prodige. Trois destins réunis par hasard, dans la vibration discrète d’une amitié naissante. Rien ne les prépare à ce qui va suivre. La guerre, comme toujours, décide à leur place. Ren est envoyé en Mandchourie. Il en revient mutilé : visage et main irrémédiablement marqués, le geste du peintre brisé net. On croit à un effacement.
Mais Mizubayashi sait que certaines renaissances commencent dans le noir. C’est Yuki qui rallume la première étincelle. Pas par miracle, pas par grande déclaration mais par la lente persévérance des gestes quotidiens, par l’entêtement à croire qu’il y a encore quelque chose à dire, à peindre.
Ren reprend les pinceaux.
Il ne peint plus comme avant : il compose quinze toiles monumentales, une suite qu’il appelle La forêt de flammes et d’ombres. On les imagine brûlantes, traversées de rouge et de noir, hantées par la guerre mais tendues vers autre chose.
Yuki aussi bien que Kyoko, M. et Mme Yamada revoyaient en pensée chacun des quinze tableaux de La Forêt de flammes et d’ombres, conservés dans trois endroits différents en raison de la dimension importante de l’œuvre : l’atelier de Ren et Yuki, la galerie de Kyokoet la réserve des Beaux-Arts. […]La peinture de Ren paraissait totalement abstraite au premier abord. La surface rectangulaire était chargée et même surchargée de toute une gamme de rouges, allant du rouge vif au rouge presque noir. Il y avait aussi du jaune, du vert, de l’orange, du brun, du marron foncé, du noir et quelques petites touches de blanc. La surface colorée d’une frénésie nerveuse était souvent inégale en ce sens que, par endroits, il y avait des couches de pigments superposées comme dans certains tableaux de Nicolas de Staël. Étrangement, tous les quatre éprouvaient, à la vue de cette extraordinaire déflagration de couleurs et de formes fuyantes mais pré-cises, à travers aussi les mystérieuses oscillations de lignes noires qui traversaient les deux tableaux, toute la douleur du peintre qui se confondait avec celle du monde.
Chacun vivait un moment hors du temps.
L’art, ici, n’est pas un refuge : c’est une contre-offensive. Les toiles de Ren parlent sans légende, refusent le pathos, mais disent tout, la brutalité des nationalismes, l’absurdité du pouvoir aveugle, le prix payé par les corps et les visages. Parallèlement, Bin, devenu musicien reconnu, porte la mémoire de Ren et Yuki sur les scènes du monde. Yuki, elle, reste la gardienne des tableaux, puis fonde un musée pour les préserver. Les années passent, les vies se déplacent, mais la peinture et la musique continuent de battre comme un cœur souterrain.
La narration avance comme une partition de musique de chambre : les trois voix se répondent, se perdent, se retrouvent, dans un mouvement souple où chaque silence compte. Mizubayashi orchestre ces retrouvailles avec une retenue qui rend l’émotion plus vive. On ne tombe jamais dans la grandiloquence : la douleur est là, entière, mais tenue à distance par la délicatesse de l’écriture.
Car c’est là le paradoxe du style de Mizubayashi : il écrit comme on caresse, mais la caresse, parfois, révèle la brûlure. Sa phrase est ample, lumineuse, et pourtant chaque mot garde un tranchant discret. On sort du livre avec un mélange d’apaisement et de trouble, comme si l’on avait traversé une forêt où les flammes et les ombres cohabitent et que cette coexistence était, peut-être, notre seule manière de tenir debout.
On y retrouve la douceur acérée qui fait la marque de l’auteur : des phrases qui semblent caresser la peau et, par en dessous, écorcher la mémoire. Mizubayashi ne cherche pas à « raconter » la guerre : il l’encercle, il la transfigure par l’art et l’amour, jusqu’à la réduire à ce qu’elle est.
La forêt de flammes et d’ombres est un roman de guerre qui refuse d’être un roman de guerre. Un livre sur la douleur qui, page après page, choisit la beauté.
Akira Mizubayashi, La forêt de flammes et d’ombres, 288 pages, 21 euros.
Éditions Gallimard, collection Blanche https://www.gallimard.fr
Parution le 14 août 2025
