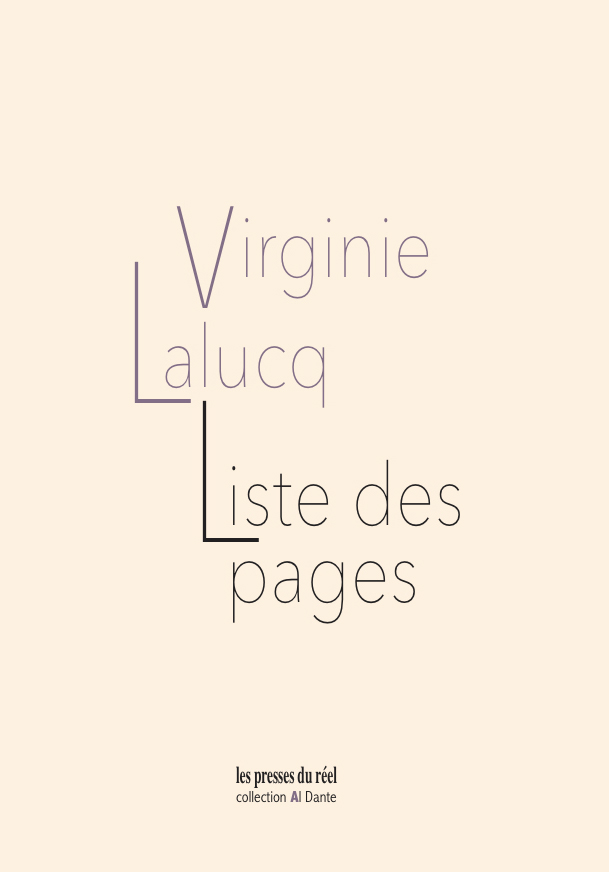Une poésie du tenir debout quand le corps chancelle
Virginie Lalucq n’écrit pas pour ranger des poèmes dans une bibliothèque, mais pour ouvrir des failles. Ses mots grattent, trébuchent, surprennent. Sa langue n’est jamais lisse : elle résiste, elle respire autrement. Ses livres lient l’intime et le collectif, le quotidien et le politique, le corps et la pensée. Sa poésie, souvent qualifiée d’expérimentale, met à l’épreuve la langue sans jamais perdre contact avec le réel.
Son écriture se caractérise par une recherche formelle exigeante, une attention au langage comme matière vivante et un goût marqué pour le dialogue entre les disciplines. Dans Liste des pages, on croise Collobert, Dickinson, Morisot, Kafka, pas pour nommer mais pour tenir bon.
Ce recueil se lit comme une constellation. Les pages s’appellent les unes les autres, se dispersent, s’illuminent à distance. Il accueille ce qui déborde, ce qui échappe, ce qui vacille. Dans cette discontinuité s’affirme une force politique : refuser le récit univoque, préférer l’éclat, la faille, l’arpentage.
En refusant la narration classique : elle n’inscrit pas de récit héroïque ni de continuité romanesque, mais des éclats qui scandent l’épuisement, des fragments qui avancent comme un souffle haché, une syntaxe qui se brise et se relève.
Octobre, novembre, décembre : un calendrier qui n’ordonne rien mais compte à rebours.
Cette fois Octobre a fichu le camp, comme tu y vas Novembre, de ton silence radio. Ton nénuphar s’est froissé en route, la corolle n’est plus que congère. Pas dit que tu passes la saison des perce-neige. Ou alors tu tomberas sans perdre ta forme, tes étamines tiendront peut-être le coup. A la saison des lucioles, le cyanure aura remplacé le laudanum. Et tandis que tu épuiseras le Bescherelle avec tes grands airs de Beata Beatrix, l’entre-temps, n’en reviendra jamais augmenté.
La maladie n’est pas ici un sujet mais une condition d’écriture. Elle est le point de bascule, Virginie Lalucq écrit depuis le bord, dans la cassure. La langue tantôt resserrée jusqu’à l’étouffement, tantôt étalée dans la page comme pour reprendre haleine. Elle glisse de la prose au vers sans prévenir, cherche ses appuis, ses silences, ses élans. Ce n’est pas du style : c’est un état. Celui d’un corps qui tente de tenir encore, par le mot.
Car c’est bien cela : une poésie du tenir debout quand le corps chancelle.
Dans Liste des pages, le corps est central, mais il n’apparaît jamais dans le langage médical. Comment avez-vous travaillé cette présence corporelle sans passer par le vocabulaire clinique ?
Je suis partie des états du corps qui faiblit face à la progression de la maladie, un corps qui perd ses forces vitales et tout ce qui pouvait le traverser plutôt que d’élaborer une clinique objective. Ce qui m’intéressait, c’était d’explorer les états de conscience qui traversent la personne affaiblie. Etats qu’elle ne peut notifier justement au moment de l’expérience de cette perte. Ce qui la sépare du monde des vivants, aussi. Et ce qui reste de la vie, la vie qui continue malgré tout, une forme d’humour dérisoire, les souvenirs qui se précipitent. Quelques termes, symptômes donnent des pistes médicales, on comprend qu’il y a des chutes, des pertes de consciences, des syncopes, mais cela reste très flou, si bien que pour quelques lecteurs, il n’était pas évident que le livre traite même de cette question. On sait que cette voix « ne peut compter que jusqu’à six », comme les six mois qui lui restent à vivre et en réalité, cela fera quatre. Car la voix cesse de parler brutalement au terme de l’hiver, d’où la forme finale (La fin du langage = la fin de vie). Écrire sur la question de la maladie tout en n’étant pas malade était un pari contre moi-même. Il fallait trouver des équivalents émotionnels, entendre et comprendre ce que m’en disaient mes proches malades sans s’approprier leur histoire, former des hypothèses de langue avec ce paradoxe de choisir une forme qui incitait à penser qu’il s’agissait d’un témoignage – la poésie. Or il ne s’agissait pas de témoigner de soi contrairement au récit habituel de la maladie mais pas non plus des autres. Ne pas parler à leur place, mais plutôt avec eux. Et trouver une syntaxe qui puisse dire la catastrophe personnelle qui vous tombe dessus, une syntaxe « en avant droit dans le mur ».
Votre écriture semble épouser les failles, les cassures, presque comme si la syntaxe devenait un corps qui se brise. Écrire, est-ce pour vous une manière d’accompagner la défaillance ?
J’aime beaucoup cette façon de décrire Liste des pages, c’est un livre qui, oui, épouse les failles ou ce qui est supposé comme tel, que vous y voyiez une syntaxe à la mesure d’un corps qui se brise est juste car j’ai précisément travaillé à fragmenter la syntaxe. L’inverse d’une langue musclée, roulant des mécaniques, dans l’épreuve de force avec le lecteur, en somme, une langue vulnérable qui accepte aussi son impureté. Dans mes textes, la maladie ne constitue pas simplement la question de l’individu mais aussi la dimension collective de la manière dont notre société traite ceux qu’elle perçoit comme marginalisés ou faibles, dans une époque particulièrement normative et qui tend à rejeter ce qu’elle estime de l’ordre de la déficience. Ce qui m’a beaucoup touchée, c’est qu’au final, le livre ait été bien reçu par des personnes ayant traversé cette épreuve, ce qui était une angoisse et m’a longtemps retenue de faire paraître le livre. Alors oui écrire les forces des faiblesses, avec cette idée aussi qu’écrire c’est toujours avec et dans l’inconnu qui s’énonce à vous, à tâtons et à l’aveugle : « Ecrire. Je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire : on ne peut pas. Et on écrit. C’est l’inconnu qu’on porte en soi : écrire, c’est ça, qui est atteint. C’est ça ou rien. On peut parler d’une maladie de l’écrit. » (Duras)
Le livre refuse la narration continue, la linéarité. Pourquoi ce choix d’une écriture fragmentaire ?
J’ai toujours aimé les écritures fragmentaires au sens où cette forme parcellaire crée un mouvement. Ici les fragments sont des unités de notes qui procèdent comme des constellations agissant entre elles. Ecrire de manière fragmentée et non-linéaire donne le champ à une écriture plus ouverte. Mais surtout cette discontinuité me semblait correspondre avec l’état maladif et les pensées ou images qui surgissent alors de façon désordonnée du fait de l’état de fatigue et de l’état émotionnel, dans un continuum qui est celui de la maladie comme espace-temps donné. J’ai voulu aussi associer plusieurs voix : les fragments se répondent, se prolongent en forme de polyphonie. Il y a entre autres quelques fragments qui parlent de Danielle Collobert et je suis heureuse qu’un lecteur allemand fin connaisseur de sa vie et de son œuvre, Peter Bouscheljong l’ait bien lu ainsi*.
* « I think there are some poems in your book (such as « Tous tes os sont brisés…p.22 ») that reflect Danielle’s life exceptionnaly » ; j’ajouterais le fragment de la p.31 « Soit la phrase : Ses amis ont ignoré pendant près de trois mois sa disparition dans P. »
Vous avez choisi de conclure le livre par une “bande-son”. Comment cette playlist a-t-elle accompagné ou prolongé l’écriture ?
Tous mes textes comportent des références musicales, des allusions à des chansons qui me sont chères, ou des greffes de refrains, variations même, parfois. J’écris souvent dans la musique. Pour Liste des pages, j’ai voulu créer un temps qui soit rythmé par elle, d’où une bande-son. Des ritournelles qui font tenir, accompagnent le quotidien du corps en train de décliner. Certaines chansons encadrent les mois qui scandent le livre comme « November spawned a monster », « Pâle décembre » ou encore « Février ». D’autres comme « Jesus blood never failed me yet » sont reproduites dans le texte. Mais il y a aussi Bashung, avec les albums Play blessure et Fantaisie militaire qui m’ont inspirée pour leur liberté syntaxique, un certain décalage trivial et abstrait en même temps. Il y a aussi des chansons qui ne figurent pas dans la bande-son finale, par exemple « Never let me down again » de Depeche mode à laquelle il est fait allusion qui est peut-être est centrale car ce texte c’était un « taking a ride / with my best friend » qui traversait un cap difficile. Ou encore le groupe lyonnais Ödland présent dès l’ouverture du texte auquel il est fait clin d’œil via un terme médical. La bande-son était aussi là pour qu’on s’y réfère et qu’on aille découvrir les chansons dont la plupart ne sont pas forcément très connues. Qu’on lise les pages avec la (play)list, qu’on retrouve éventuellement les passages où les chansons sont samplées, aussi. Qu’on aille écouter avant, pendant ou après lecture.
Votre texte refuse aussi l’héroïsme du récit de maladie. Est-ce une position à la fois éthique et esthétique ?
L’expérience de la maladie grave, c’est la déréliction. La plus grande des solitudes, elle isole des vivants et de leurs logiques, créée une lourdeur abrupte. Tout paraît dérisoire, du moins c’était mon hypothèse. Le seul héroïsme est de s’en tirer vivant ou de survivre le temps qui nous est donné, s’en tirer vivant n’étant pas le fruit d’un courage particulier mais d’une contingence pure. Si je m’attaquais à cette question frontalement, je ne voulais pas me faire porte-parole de, ni parler à la place de. Il s’agissait d’une position tout autant éthique qu’une question de forme, à savoir, développer une écriture accompagnant les failles, une poésie qui ne fasse pas de la gonflette mais pas plaintive non plus, non sans force, il n’y a pas plus grande force que d’affronter la mort en connaissance de cause (« même si le soleil ni la mort ne peuvent se regarder en face »). Il fallait à la fois faire avec le pathos – impossible à éviter dans pareille situation d’énonciation mais ne pas s’y complaire non plus, d’où l’humour féroce qui a été notifié par certains lecteurs et une écriture brève, voire une écriture d’anti-héroïne.
La poésie contemporaine oscille souvent entre récit autobiographique et expérimentation formelle. Où situez-vous Liste des pages dans ce paysage ?
Dans Liste des pages, j’ai voulu faire aller lyrisme et expérimentation ensemble, deux écoles qu’on oppose souvent, il me semblait qu’explorer cette question rendait les deux indissociables, comme de fusionner les contraires. Mais le texte n’est pas à proprement parler autobiographique : ce n’est pas le récit de ma maladie, comme le ferait une poésie lyrique classique et c’était aussi la difficulté d’écrire contre soi-même en pleine santé, une mise en danger. Les seules pages référant à des choses que j’ai vécues sont les pages consacrées aux souvenirs accélérés dans une sorte de flux de conscience, qui sont mes propres souvenirs, car je ne me voyais pas d’en inventer ou de puiser dans ceux de mes proches. Je travaille les pronoms personnels « je » et « tu » comme des personnages à part entière. J’aimais bien ainsi le tu d‘Apollinaire, dans Zone, « A la fin tu es las de ce monde ancien ». Passer par l’adresse indirecte permettait déjà une forme de distance fictive. Donc un livre qui est de l’ordre de l’expérimentation formelle en même temps qu’une « autobiographie de tout le monde », pour paraphraser Gertrude Stein.
Quelle place occupe aujourd’hui pour vous la voix, à la fois voix sonore et voix intérieure, dans votre travail poétique ?
J’ai commencé à écrire avec l’idée de faire de la musique car la musique a toujours été primordiale pour moi. Or je ne suis pas musicienne ni chanteuse. Écrire de la poésie, c’était faire de la musique mais avec les moyens des mots. Toute poésie est sonore. Une grande partie de mon travail, dès Couper les tiges est préoccupé par la question de l’oralité, les textes sont souvent dialogués, il y a des ritournelles enfantines détournées, mais c’est aussi une poésie très écrite traversée par des voix internes, des polyphonies, un brouillage énonciatif, la confusion des genres et des voix translangue aussi, on se demande souvent qui parle dans mes textes. Puis l’expérience de la lecture à voix haute, des collaborations avec des poètes ou des lieux de performance m’ont amenée à explorer les possibilités de la voix dans le fait de dire, improviser, chercher. Je suis amenée à développer cet aspect sonore et donc de travailler avec ma voix différemment, cela me réjouit.
Quel serait le mot, ou le silence, que vous aimeriez que le lecteur garde en lui après avoir refermé Liste des pages ?
Survie, un mot qui s’applique à beaucoup de situations contemporaines, plus que jamais et qui est aussi le titre d’un livre de Danielle Collobert.
Quels sont les auteurs, poètes ou artistes qui nourrissent votre écriture et accompagnent votre travail ?
Ils sont nombreux.se.s. Pour ce livre précisément : Danielle Collobert, Anne-Marie Albiach, Emily Dickinson, Gertrude Stein, Astrid Lindgren, Berthe Morisot, Joanna Newsom, Elisabeth Siddal, Huguette Champroux et T.S Elliott, Jean de La Fontaine, François de La Rochefoucaud, Olivier Sterne, Jonathan Swift, Franz Kafka, Heinrich Von Kleist mais aussi Le Caravage dont un Saint-Mathieu et l’ange détruit pendant la Seconde guerre mondiale est reproduit dans le livre. Sinon j’aime le travail d’Eustache Deschamps, Marguerite de Navarre, Félix Fénéon, Raymonde Linossier, Marguerite Duras, Samuel Beckett, Agnès Rouzier, Christophe Tarkos, Jacques-Henri Michot, Charles Pennequin, Carmen Diez Salvatierra, AC Hello, Pascale Petit, Hortense Gauthier. Je songe aussi aux romanciers Nathalie Dentinger et Arno Calleja, dont le souci de la langue et l’originalité dans des registres différents me réjouissent et me donnent à penser. Je viens également de découvrir la poésie visuelle de toute beauté de Wonwoo Kim parue récemment aux éditions du Bunker : Hiver Chute Vie. Un coup de cœur !
Enfin, quelle est votre actualité littéraire, artistique ou à venir ?
Je réalise actuellement deux livres d’artistes. L’un avec le plasticien et musicien Frédéric Harranger, qui sera un objet unique et dont l’écriture est achevée, Prairie supérieure, où il est question de méduses qui envahissent une prairie ainsi que de toute une ménagerie marine vénéneuse et les contaminations possibles qui en découlent. Puis un projet qui me tient à cœur avec la photographe Natacha Nikouline. La Mort donne un sens à l’objet, en cours d’écriture et qui relie les questions de vie et de mort, d’infini et finitude, par un dialogue texte/image qui se demande si ces deux ordres sont si séparés qu’on veut bien nous le faire croire. Je participe aussi au numéro 4 de la revue Olga, poésie non-poésie [LE LIVRE de (STEVE) JOBS] avec un texte et également une Musique entraînante pour ne pas réussir dans la vie, exploration électroaccoustique. Le numéro sera présenté au salon des revues du 10 au 12 octobre et fera l’objet de l’émission radiophonique Les Oreilles libres sur radio libertaire, à laquelle je participerai le 17 octobre prochain. Puis un article sur la question du politique chez Emily Dickinson et un texte de création sont à paraître dans la toute nouvelle revue Volodia, en fin d’année 2025. Enfin, un duo sonore à partir de mon texte Rhapsodie Napalm avec la poétesse, performeuse et musicienne, Hortense Gauthier, qui aura lieu en novembre et qui donnera lieu à d’autres prolongements car nous avons envie de pousser l’aventure plus loin, nous cherchons d’ailleurs un lieu de résidence pour travailler ensemble, avis lancé !
Liste des pages, Virginie Lalucq, Les presses du réel, 48 pages, 10 €
Collection Al Dante, date de publication 2 novembre 2023
www.lespressesdureel.com
© Sophie Carmona & Virginie Lalucq